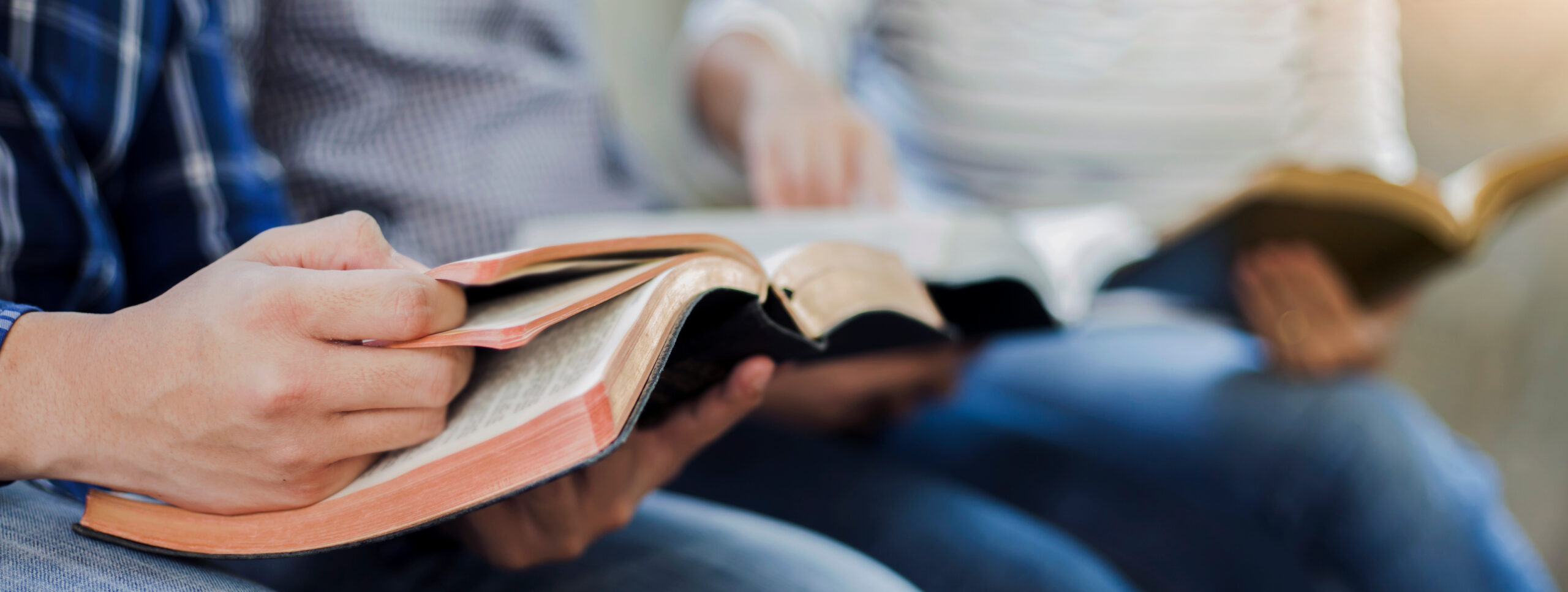
Christine Chartier et Élisabeth Rattier sont respectivement directrice régionale et responsable de projets du CLAP Sud-Ouest (Comité de Liaison des Acteurs de la Promotion), dont le projet « PASS R.E.L », centré sur la lutte contre l’illettrisme, s’est déroulé de fin 2022 à fin 2023. Il a été financé par l’appel à projets régional « innover contre l’illettrisme en Nouvelle-Aquitaine ».
Comment avez-vous élaboré PASS R.E.L. ?
Notre projet est parti du constat de la difficulté à toucher les personnes en situation d’illettrisme et à les envoyer en formation. Ainsi que d’un décalage entre le nombre de personnes en situation d’illettrisme déclaré et celui des personnes reçues sur la plateforme, soit un peu plus de 2 000 par an sur la Gironde. Avec le groupement des organismes de formation de Bordeaux proposant l’HSP Socle – parcours 1 (illettrisme), nous avons convenu qu’il valait mieux unir nos forces pour répondre à cet appel à projets. Le CLAP, porteur du projet, a répondu sur l’axe réseau et sensibilisations, les organismes de formation pour la mise en place d’actions Premières marches.
Le principe était de couvrir toutes les étapes amenant le public en situation d’illettrisme vers les organismes de formation ou d’autres structures. Cela implique de sensibiliser les acteurs du territoire, leur donner des outils de repérage et de faire en sorte de faciliter le parcours des personnes. En agissant en amont, en aval, pendant et jusqu’à l’arrivée des publics sur les dispositifs de formation.
Par quel biais les publics arrivent-ils à votre plateforme ?
Par les prescripteurs traditionnels, mais aussi toutes les structures de proximité. En fait, tout partenaire peut nous envoyer du public. Il y a aussi des personnes qui viennent directement prendre rendez-vous. Le public en difficulté avec la langue française va vite exprimer son besoin, spontanément. C’est plus difficile pour une personne en situation d’illettrisme, qui a souvent un sentiment de honte, de déni, et qui met en place des stratégies de contournement. C’est un public qui souhaite se former pour gagner en autonomie, il faut le rassurer dans sa capacité de réapprentissage.
Quel a été l’apport du projet PASS R.E.L ?
Nous avons pu sensibiliser plus de 300 professionnels dans une centaine de structures. Ainsi que le grand public avec deux soirées événementielles organisées dans le cadre des JNAI. Une soirée ciné débat, et une soirée théâtre avec une troupe composée de personnes en situation d’illettrisme qui ont pu échanger avec le public. Ces actions ont permis de créer un réseau d’une dizaine de référents illettrisme au sein des structures, ainsi que d’élaborer une charte du référent illettrisme et un kit communication, avec notamment une fiche d’accueil et de repérage.
Tout ce travail a perduré après PASS R.E.L., sous forme de partenariat renforcé entre la plateforme et les organismes de formation. On a mis en place de nouvelles modalités d’accueil du public et un suivi renforcé, notamment dans le cadre des HSP. Au besoin, on accompagne les personnes dans les structures de formation, qui sont parfois situées au sein d’établissements scolaires. C’est une situation qui peut être angoissante pour elles.
Le rapport négatif à la formation qu’ont ces publics est souvent évoqué, est-ce qu’il est systématique ?
Non, pas toujours. Il y a plusieurs facteurs qui se combinent, le parcours scolaire en fait partie. Ce n’est pas forcément lié à la scolarité en soi, ça peut être dû à l’environnement familial et social qui fait que la scolarité est segmentée. Ça peut aussi être une question de santé. En tout cas, certaines personnes n’ont pas bénéficié de conditions familiales, personnelles, sociales, très favorables à leur apprentissage.
Constatez-vous une différence dans les situations d’illettrisme entre milieu urbain et milieu rural ?
En fait on retrouve exactement le même type de profil, même si en ruralité ses posent des questions particulières comme celle de la mobilité. Nous avons l’impression que l’approche des partenaires et des prescripteurs est la même dans ces deux types de territoires. Cela dit, il nous semble que c’est plus difficile en milieu urbain parce que les réseaux sont complexes, il y a plus d’anonymat. Le travail partenarial est plus simple en secteur rural, parce qu’on arrive mieux à mobiliser tous les intervenants afin d’avoir un plan d’action partagé. En ville, le nombre de partenaires est plus important, c’est délicat d’entraîner tout le monde dans la danse de l’illettrisme, sachant que leurs priorités se portent plutôt sur les besoins en FLE. De plus, les publics en milieu rural ont moins de référents, un ou deux, alors que sur la métropole ils en ont plusieurs, et c’est parfois compliqué de s’y retrouver.
Qu’en est-il des décideurs locaux ?
Nous rayonnons sur la Nouvelle-Aquitaine, on est confrontés à différents environnements. Chez les élus, c’est un peu comme sur la question du handicap. Certains, pour des raisons de parcours personnel ou selon leur territoire, s’emparent vraiment du sujet. D’autres ont moins cette prise de conscience, ils font partie des acteurs que nous devons sensibiliser. Comme les agents des collectivités territoriales qui sont en première ligne sur toutes les démarches d’état civil. Ils voient surtout des personnes venant d’autres pays, qui parlent mal le français. Mais le public en situation d’illettrisme reste la grande inconnue.
Quelles conclusions tirez-vous de la mise en place de ce projet ?
Notre difficulté, c’est qu’il était tout de même particulièrement ambitieux, entre les sensibilisations, la création du réseau, la coordination avec neuf organismes de formation. Plus il y a du monde, moins c’est simple, et c’est beaucoup d’énergie. Nous avons été agréablement surpris par l’implication des partenaires et l’intérêt suscité par cette problématique de l’illettrisme.
Ce qui est positif aussi, c’est que certaines actions perdurent, la dynamique partenariale est maintenue avec les organismes qui continuent à nous envoyer des personnes avant l’entrée en formation, notamment grâce au réseau de référents constitué d’un noyau dur. On peut citer la mission locale Hauts de Garonne, avec laquelle on entretient un partenariat renforcé et de qualité. Nous y tenons une permanence. Et une professionnelle de l’équipe est plus particulièrement référente du sujet auprès de ses collègues.
Il arrive aussi qu’une fois que nous avons sensibilisé des conseillers, au niveau des structures, ça ne suit pas. Ce n’est pas dû à un manque d’intérêt, mais ils sont souvent happés par d’autres priorités. C’est pour ça qu’on milite pour avoir des référents illettrisme qui soient un vrai relais et poussent leurs collègues à rester vigilants. Donc, il nous faut continuer à porter cette cause pour qu’elle devienne un vrai sujet partout. Nous pensons qu’il y a une carte à jouer au niveau des entreprises. Aujourd’hui, nous n’y allons peut-être pas assez.
Quelle est la situation dans les entreprises ?
On retrouve plus particulièrement ces publics dans certains secteurs professionnels ou bien souvent s’ajoute la pénibilité. Le risque est qu’ils peuvent se trouver en incapacité d’exercer leur activité, et que leur reclassement peut s’avérer très complexe. À partir du moment où une personne a été stabilisée sur un poste, elle arrive à le maîtriser par différentes mécaniques, des stratégies de contournement ou des systèmes aménagés par l’entreprise. Le problème, c’est lorsqu’un changement de process intervient, une difficulté de santé, voire une proposition de promotion ou de formation en interne. Dans ces situations, la personne se retrouve en difficulté, et c’est là que l’illettrisme se voit le mieux. Mais de la même manière dans la vie quotidienne, dans la vie sociale, à chaque fois qu’elle est dépendante de quelqu’un d’autre.
Tout cela relève de la responsabilité sociale de l’entreprise. Aujourd’hui, beaucoup de secteurs se trouvent en difficulté de main-d’œuvre, donc ils ont aussi intérêt à faire en sorte que ces personnes ne partent pas. Au niveau des entreprises, nous avons un vrai chantier, notamment celui de leur faire mesurer ce que « coûte » une personne en situation d’illettrisme en termes de risques ou de rentabilité. Ne serait-ce que parce qu’une chaîne de production peut très bien s’arrêter brutalement en raison du dysfonctionnement d’une seule personne.
Site web : maia-education.fr
Cet article est publié pour le compte de « La Place », la plateforme collaborative créée par la DGEFP, dédiée aux acteurs du Plan d’Investissement dans les Compétences et du PACTE de la Région Nouvelle-Aquitaine :
